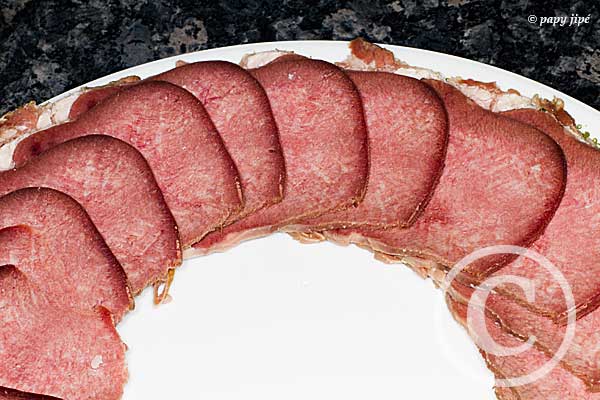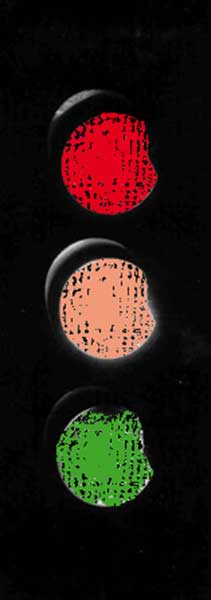Je n’ai rien inventé.
Je n’ai rien découvert.
Je ne suis ni ingénieur, ni inventeur.
Il n’y a donc, ipso facto, pas la moindre petite raison que l’on se souvienne de moi et que mon nom passe à la postérité.
D’ailleurs, j’ai encore un autre défaut.
Je ne suis pas suffisamment orgueilleux pour me prendre au sérieux et me mettre en scène moi-même.
De m’auto produire en quelque sorte.
Pourtant, le proverbe le précise :
« on n’est jamais mieux servi que par soi-même »
Alors si d’aventure, je ne m’occupe pas de moi, qui diantre, le ferait à ma place ?
Il n’y a que les « grands hommes », enfin, je veux dire, ceux qui se prennent suffisamment au sérieux, qui osent déclarer ouvertement qu’ils sont Grands et ceci sans même attendre leur mort, de leur vivant !
« On n’est jamais mieux servi que par soi-même… »
Oh !
Pouvoir être le témoin de son propre enterrement ; être le témoin privilégié d’un hommage qui se veut habituellement posthume.
Posthume : c’est-à-dire quand on est passé de l’autre côté, quand on a fini d’être humain, quand on vous a inhumé, déshumanisé.
C’est pas beau le vocabulaire !
Il y a de quoi faire flipper. Non ?
Grand père était horloger. C’est du moins ce que je croyais, mais après avoir approfondi mes recherches, j’ai découvert qu’il n’était pas horloger de métier. Il était horloger de la pire espèce, par vocation, par bonheur de trafiquer les horloges et les montres.
Qui sait peut-être avait-il l’illusion d’apprivoiser le temps, de le dompter.
Toujours est-il, que même sans être professionnel, grand-père n’en possédait pas moins un véritable atelier avec toute la ribambelle des outils qui allait des simples tournevis, aux outils d’un graveur, car à l’époque, les montres de gousset étaient personnalisées et on y gravait le nom de l‘heureux propriétaire.
Parmi les outils, il y en avait de bien tentants notamment un tour en laiton avec une grande roue que l’on actionnait à la main et qui entrainait par un savant jeu de courroies une roue plus petite que enserrait l’outil. Grand père ne se contentait pas de faire de l’assemblage, non, il tournait lui-même les pièces dont il avait besoin.
L’atelier du grand père était le saint des saints : endroit des plus sacré dans lequel j’étais admis, disons plutôt toléré, à condition de garder mes mains dans les poches, meilleur moyen d’être sûr que je ne touche à rien.
J’en ai vu des choses incompréhensibles dans cet atelier !
J’y ai assisté à de véritables interventions chirurgicales quand grand père opérait à cœur ouvert, une horloge gravement malade.
Dans cet atelier, j’ai appris le silence, celui des grandes occasions, celui des minutes décisives, des décisions irréversibles.
Des silences oui, mais j’ai également appris à distinguer la régularité du rythme cardiaque. Je vous le jure, les tics tacs ne se ressemblent pas.
Grand père ne parlait pas souvent. Il émettait des grognements d’agacement, des ponctuations de mauvaise humeur, ou alors de grands soupirs de contentement.
Pourtant, et sans toucher à rien, ou alors en effleurant d’un simple regard, j’y ai appris beaucoup de choses, comme le respect de la belle mécanique et du travail bien fait.
J’y ai appris, l’importance du plus petit des rouages, une importance capitale car il suffit d’un tout petit grain de sable pour…Mais vous connaissez la suite.
C’est peut-être dans l’atelier de l’ancêtre que s’est mise en place, sans que j’en sois conscient une certaine façon de penser, de voir les choses, d’appréhender la Vie et les gens.
Je n’ai rien découvert.
Je n’ai rien inventé.
Mon nom ne sera pas graver pour l’éternité
l’éternité des hommes s’entend-il !
Celle qui ne dure que le temps d’être oublié
Et je ne le regrette pas.
Je n’ai fait que mon humble travail de petit rouage, anonyme et indispensable
Un petit rouage de la machine d’éternité.
Views: 1819